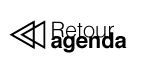Avec : Katinka Bock, Vittorio Cavallini, León Ferrari, Theresa Hak Kyung Cha, Sojung Jun, Rose Lowder, Huda Lutfi, Ernesto Oroza, Somnath Mukherjee, Remzi Rasa et Vuth Lyno.
Tell me the story of all these things. Beginning wherever you wish, tell even us. constitue l’exposition inaugurale du programme Autohistorias déployé sur l’année 2017 sur nos deux sites d’activités : le centre d’art et de recherche Bétonsalon et la Villa Vassilieff. Autohistorias se propose d’imaginer une histoire partagée, une histoire qui ne soit pas imposée mais élaborée collectivement d’après une multiplicité de particularités et d’itinéraires sinueux dans un monde fragmenté.
Tell me the story of all these things. Beginning wherever you wish, tell even us. emprunte son titre à Dictée, roman autobiographique expérimental écrit par Theresa Hak Kyung Cha en 1982. Dans ce texte, l’artiste coréenne évoque son expérience de l’exil – en différentes langues et en combinant texte et images dans une variété de registres narratifs, au travers des histoires de plusieurs femmes associées aux neufs muses de la mythologie grecque. Ce dense enchevêtrement de récits individuels de circulations et de migrations est le projet même de l’exposition Tell me the story of all these things. Autour de Sojung Jun, Pernod Ricard fellow en résidence à la Villa Vassilieff pour qui Dictée représente une importante source d’inspiration, l’exposition aborde l’expérience du déplacement et des sentiments qui y sont associés tels que la perception du seuil entre l’intérieur et l’extérieur, la conscience d’une identité mouvante et multiple ou encore les affects nés de l’éloignement ou de l’intensité de la proximité.
C’est sous la forme d’un aparté que débute au rez-de-chaussée le parcours de l’exposition : un ensemble de vidéos de Sojung Jun, qui dessine des micro-récits de personnalités marginales et de traditions locales menacées, est présenté en regard d’une sélection de films de la cinéaste expérimentale Rose Lowder, qui alternent entre expérimentations sur la pellicule même du film, jeux graphiques de formes colorées et observation du temps qui passe dans une approche légèrement plus documentaire.
Rose Lowder et Sojung Jun emploient, l’une comme l’autre, des éléments textuels dans la composition de leurs images en mouvement, allant de la simple lettre utilisée comme élément graphique à la citation littéraire. L’exposition prolonge et propage ce travail de tissage intertextuel au premier étage de la Villa, par l’entremise notamment de la singulière œuvre-bibliothèque de Bétonsalon. En 2009, Katinka Bock avait disséminé aux abords du centre d’art cent briques en terre cuite moulées à la main, que les visiteurs pouvaient emporter en échange d’un livre offert à Bétonsalon, à choisir parmi ceux de Section 7 Books de castillo/corrales, librairie parisienne spécialisée dans l’édition d’art indépendante. Une brique retrouvée dans les réserves du centre d’art témoigne ici de ce processus collaboratif de circulation des savoirs. La bibliothèque s’est quant à elle étoffée depuis 2009, entre autres des ouvrages liés à la recherche sur la synesthésie que mène Sojung Jun à Paris.
Les héliographies de León Ferrari, de par leurs compositions rhizomatiques ou « architectures de la folie » pour reprendre les termes mêmes de l’artiste, font sombrement écho au lacis de références qu’offrent la bibliothèque et l’exposition. La série a été composée pendant la dictature argentine, alors que León Ferrari était en exil au Brésil, et joue des codes de l’abstraction géométrique redéployés en de tragiques labyrinthes ne laissant aucune issue aux individus.
Afin d’inviter à prendre le temps de la lecture, la Villa Vassilieff a proposé au designer et artiste Vittorio Cavallini d’investir son espace, souhaitant que l’exposition s’inscrive dans un lieu ouvert et hospitalier proche du cadre domestique offert par Marie Vassilieff au début du 20ème siècle. Au rez-de-chaussée, d’autres éléments de mobilier ont été réalisés par l’artiste cubain Ernesto Oroza, Pernod Ricard fellow 2016, lors d’un workshop organisé pendant sa résidence à Paris.
Tell me the story of all these things s’attache à présenter des trajectoires individuelles faites de glissements, façonnant des identités en perpétuelle transformation. De 1972 à 1982, Remzi Raşa a inlassablement peint le mont de la Fournache dans la Drôme, qui lui rappelait les montagnes du Kurdistan dont il était originaire. Remzi Raşa a été formé à la peinture à l’école des Beaux-Arts d’Istanbul par le peintre Léopold Lévy – photographié par Marc Vaux – appelé par l’ancien président de la République de Turquie Mustafa Kemal Atatürk pour « occidentaliser » la peinture turque. Remzi Raşa a su développer son propre langage en se nourrissant de ses diverses influences : Deux Cultures et son arrière plan rappelant les céramiques d’Iznik manifeste l’ambition d’associer la composition d’une nature morte à la complexité décorative des arts islamiques ottomans. Somnath Mukherjee est un autre artiste dont la vie incarne cet enchevêtrement des cultures lié à l’exil. Ancien cycliste indien arrivé au Sénégal dans le cadre d’une mission pour la paix en 1987, il s’est installé à Dakar où il a créé la troupe de danse Bharat-Pehchane, fruit d’un travail chorégraphique syncrétique collectif. Cette question du lien créé à l’échelle individuelle entre deux régions distinctes du monde est au cœur de la recherche présentée par Vuth Lyno sur le cas particulier de l’APRONUC (Autorité Provisoire des Nations Unies au Cambodge) qu’il présente comme une métaphore de la déviation de trajectoires.
L’invention de formes translocales est d’autant plus nécessaire en temps de conflits, comme autant d’actes de résistance. Huda Lutfi questionne ainsi la métamorphose du multiculturalisme cairote mais aussi la place de son propre travail d’artiste depuis la révolution de 2011 – date à laquelle elle a significativement commencé à inclure des éléments photographiés dans la rue, lors de manifestations notamment, dans ses œuvres. Ses sculptures, installations et collages participent d’une nécessaire déconstruction des clichés sur l’Égypte, et interrogent le privilège du regard dans l’espace éminemment politique qu’est l’espace public.
Mélanie Bouteloup et Victorine Grataloup
Evenement facebook
Infos pratiques sur Villa Vassilieff